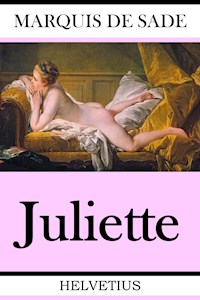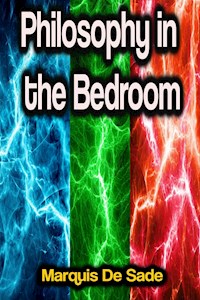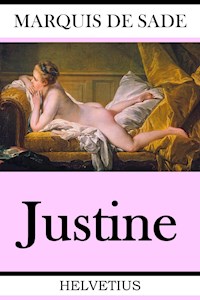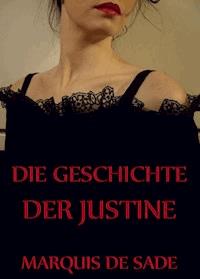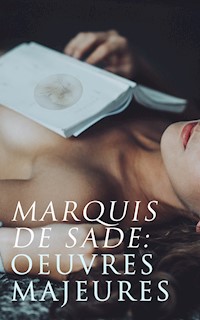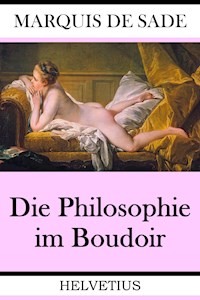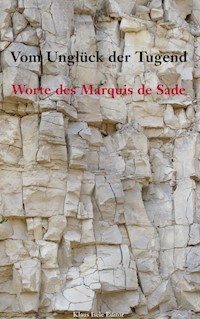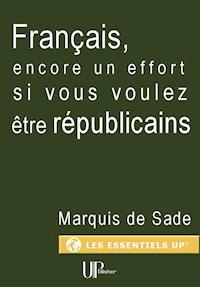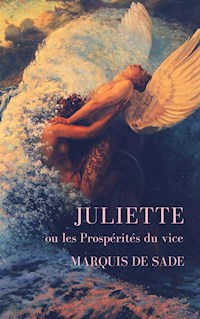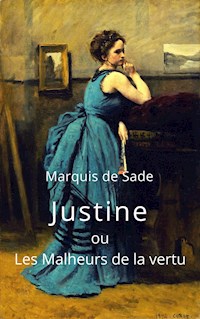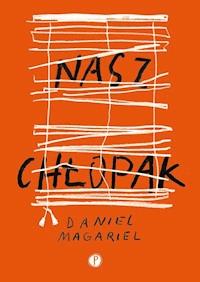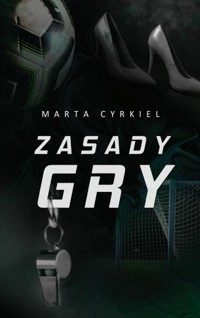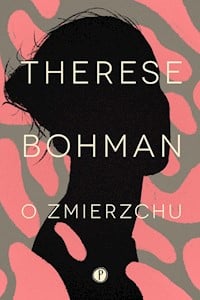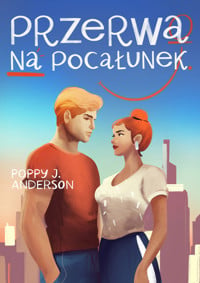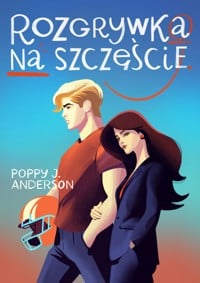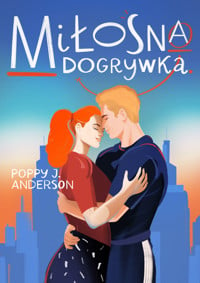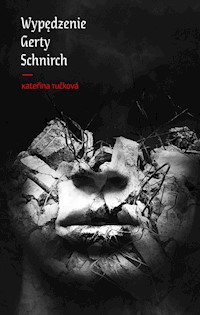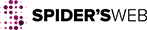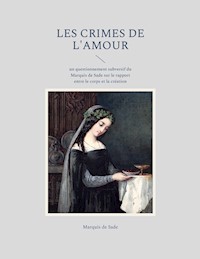
12,35 zł
Dowiedz się więcej.
- Wydawca: Books on Demand
- Kategoria: Literatura obyczajowa i piękna
- Język: francuski
Les Crimes de l'Amour est une oeuvre écrite par Le Marquis de Sade. On parle des délices de l'amour. Sade choisit d'en évoquer les crimes. L'amour devenu passion brûle tout ce qui n'est pas lui. La passion de Sade, dans ces nouvelles, est une passion incestueuse. M. de Franval aime, à la folie, sa fille Eugénie. La malheureuse Florville, après avoir été séduite par son frère, sera aimée de son propre fils et épousée par son père. L'inceste, c'est l'amour absolu, l'amant se double d'un père. L'inceste est aussi la contestation absolue. Le marquis de Sade est un révolutionnaire qui renie l'ordre social et religieux du XVIIIe siècle. L'inceste, enfin, est le repli suprême sur sa propre famille et sur soi-même. Le style de ces nouvelles est admirable. L'action en est mouvementée, sanglante. Le clair-obscur de chaque être, Sade, l'a mis à nu avec génie.
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:
Liczba stron: 238
Rok wydania: 2022